
Image d’illustration : Pixabay.
Quel rapport à l’intérêt public les reporters de guerre entretiennent-ils face au danger ? Prennent-ils plus de risque pour une information qui serait davantage d’intérêt public ? Présentation d’un mémoire de fin de master qui avait pour ambition de répondre à ces questions.
Pour une jeune journaliste passionnée de géopolitique, explorer la thématique du reportage de guerre s’est rapidement imposé comme une évidence lorsqu’il a été question de mon travail de mémoire. Le journalisme de guerre existant depuis très longtemps et ayant toujours mobilisé l’attention du public et du champ professionnel, nombreuses de ses facettes ont déjà été explorées.
Dans ce travail, j’ai souhaité interroger l’essence même du journalisme lorsqu’il se joue dans un contexte particulier comme les situations de belligérance. J’ai donc choisi de m’orienter sur la question de l’intérêt public, qui est une composante intrinsèque du journalisme. En vertu de cette dernière, les journalistes de guerre choisissent-ils de se mettre davantage en danger ? J’ai donc basé ma recherche sur l’hypothèse suivante :
Plus une information relève d’un intérêt public, plus le reporter accepte de s’exposer au risque. Alors évidemment, ce constat peut paraître quelque peu simpliste, et il a en effet été infirmé lorsque je l’ai confronté aux différents témoignages des reporters. Toutefois, ce postulat permet de mettre en avant le journalisme de guerre comme une pratique plurielle. En effet, en confrontant mon hypothèse aux témoignages de sept journalistes que j’ai rencontré, j’ai pu notamment confirmer le lien fondamental entre la notion de responsabilité sociale et le métier de reporter. Celle-ci soutient l’importance d’une transmission adéquate de l’information au public afin de permettre aux citoyens de décider de façon éclairée, en donnant également une représentation équilibrée de la société (Siebert et al., 1956). Une notion profondément liée aux idéaux démocratiques.
Le journalisme de guerre recouvre des réalités complexes et multiples, qui ont par ailleurs évolué dans le temps. Les guerres totales, « conventionnelles » avec artillerie et déclarations officielles, ne sont désormais plus la norme à notre époque, exception faite de la récente guerre en Ukraine. Avec ce changement dans la façon de faire la guerre, au travers de guerres grises[1] ou de guérillas, c’est automatiquement le métier de « reporter de guerre » qui change aussi.
Les reporters peuvent être embedded[2], seuls, envoyés par leur rédaction, free-lance, ou encore aidés de fixeurs [3]. Ils peuvent faire état de réalités militaires, stratégiques, territoriales, politiques liées au conflit, mais aussi sociales, sociétales ou humanitaires, liées aux gens qui les subissent. Ces réalités que couvrent les journalistes sont pléthoriques.
Diversifier les reporters
Mon échantillon de recherche était constitué de trois hommes, trois femmes, venant de différents médiums (radio, TV, presse écrite) et de différents pays, ainsi que le chef de la rubrique internationale de la RTS, Antoine Silacci.
Comment se passe l’analyse du risque avant de partir en mission ? Sur quoi les reporters et leurs encadrants se basent-ils ? Et surtout quelle est la place donnée à l’intérêt public dans cette mise en balance ?
Jon Björgvinsson, journaliste et caméraman notamment pour la RTS, Tristan Dessert, également caméraman et journaliste pour la RTS, Margot Haddad de la chaine française LCI, Joseph Roche, reporter de presse écrite free-lance, et Laura-Maï Gaveriaux également free-lance de presse écrite, ont eu la gentillesse de me répondre.
Pas si simple
Alors forcément, dans la vraie vie, l’équation n’est pas aussi simple. Non, il n’est pas possible de dire que plus l’information relève d’un intérêt public, plus le reporter va délibérément se mettre en danger. Cette mise en balance n’est en effet ni consciente, ni automatique.
Voici pourquoi.
La nature même du risque exclut cette mise en balance : le risque est imprévisible, aléatoire et diversifié. Ainsi, il n’est pas possible de dire que le reporter s’expose plus pour amener une information d’une plus grande pertinence pour l’intérêt public puisqu’il ne sait pas qu’il s’expose davantage. Par exemple, Tristan Dessert expliquait faire un reportage dans la ville natale de Volodymyr Zelensky, relativement loin du front, lorsqu’une bombe est tombée sur la maison à côté de l’endroit où lui et son équipe se trouvaient. A ce moment-là, ils n’avaient pourtant pas estimé que les informations qu’ils recherchaient étaient particulièrement risquées. Le hasard, ou la chance, les ont épargné.
Une situation similaire s’est produite avec le reporter free-lance Joseph Roche, alors qu’il se trouvait en Ukraine, toujours en lien avec des attaques aériennes, impossibles à prévoir :
[…] est-ce que je calcule le risque ? Je ne calcule pas, je prie. Enfin t’essayes de pas penser au pire. Là dernièrement j’ai un missile Grad qui m’est tombé à près de 200- 300 mètres. Et s’il n’y avait pas eu de petites forêts derrière, je pense qu’on était mort.
Tamara Muncanovic, envoyée spéciale pour la RTS, doit faire avant chaque départ un topo sécuritaire à sa hiérarchie, topo qu’elle devra réactualiser à chaque fois que la situation change.
La première fois que je suis partie en Ukraine j’ai même mis un point intempéries parce qu’en fait il venait d’y avoir une tempête de neige donc effectivement le plus grand risque qu’on a pris c’était les routes verglassées, chose à laquelle on ne pense pas vraiment !
Jon Björgvinsson relevait aussi cet aspect : la dangerosité des routes, les aspects logistiques, (où trouver de l’essence, une voiture, un logement etc.) représentent un risque non négligeable et difficilement prévisible. (Car ils exposent les reporters à rester plus longtemps à certains endroits dangereux par exemple.) Or, le fait de s’exposer au risque par ces différents biais ne signifie pas que les informations ainsi récoltées seront plus fortement d’intérêt public, là encore les reporters ne peuvent pas faire cette mise en balance car ils ne peuvent pas prévoir à quel point ils s’exposent.
Le front n’est pas le plus dangereux
Par ailleurs, loin de ce qu’on pourrait s’imaginer, le front n’a pas été décrit comme l’endroit faisant courir le plus de risque. Il est en effet plus prévisible que d’autres zones d’un pays en guerre, comme le relevait Jon Björgvinsson : « Parce que l’avantage d’une guerre c’est qu’il y deux armées qui se tirent l’une sur l’autre. Donc au moins tu sais qui est en train de se battre contre qui, […][4] »
En outre, les risques encourus par les reporters sont très diversifiés et concernent en réalité bien plus les conséquences politiques d’une guerre que sa dangerosité armée directement. Ainsi, Jon Björgvinsson expliquait également avoir été enfermé dans les geôles d’Abou Dabi ou encore interrogé brutalement en Égypte lors du Printemps arabe, alors même que dans ces deux cas de figure il n’était pas directement en train de rechercher une information ou une image, mais sa simple présence sur place en tant que journaliste l’avait exposé directement au risque.
Un second biais qui exclut cette mise en balance automatique est le fait que souvent les reporters doivent directement se reporter à leur hiérarchie pour évaluer les risques.
Par ailleurs, les perceptions du risque sur le terrain peuvent être altérées, que cela soit en raison d’une inexpérience ou, au contraire, d’une trop grande habitude des zones de conflits. Dans les discours des journalistes rencontrés, l’instinct tient une grande place dans l’évaluation du risque.
Que disent les hiérarchies ?
Nous avons demandé à Antoine Silacci, chef de la rubrique internationale de la RTS, quel type d’information « méritait » selon lui une certaine prise de risque, (toujours mesurée) de la part de ses reporters. Il a alors été question de la plus-value éditoriale d’une couverture :
Bon, la plus grande valeur que l’on puisse apporter à notre public pour la couverture de ce genre de conflit, c’est d’avoir du témoignage de première main, du reportage maison, parce que c’est ça en fait généralement le plus frappant, le plus marquant. Et le plus informatif. Donc c’est une vraie plus-value d’être sur le terrain, vraiment.
Il appuie sur la différence forte qui se ressent au niveau du public entre le fait de prendre des images émanant d’une agence ou celles faites par des correspondants ou envoyés spéciaux dont le nom et la voix sont connus du public.
Ça nous permet d’avoir des reportages avec un énorme impact. Et ça, c’est extrêmement important, notamment pour des conflits qui durent depuis très longtemps, où il y a une certaine lassitude de la part du public.
Une bonne info ≠ plus de risque
En 2011 lors de la chute de Kadhafi, Jon Björgvinson et ses équipes pénétraient sans difficulté dans le palais de l’ancien dictateur sans être inquiétés au vu du chaos qui régnait. Ils tombèrent alors sur le cadavre du libyen dans un container, information de forte intensité sans se mettre forcément en danger ; et des situations inverses se sont également produites. Tristan Dessert expliquait aussi, pour donner un dernier exemple, que lui et ses équipes étaient tombés par hasard, dans un village en Ukraine, sur un chirurgien militaire qui leur avait expliqué à quels types de blessures de guerre il était le plus confronté, ce qui a donné des informations d’une grande pertinence sur les difficultés du front, tout en ne les mettant pas directement en danger.
L’appréciation du risque demeure une question de sensation, de « feeling ». Il n’y a jamais de grille ou de garantie absolue.
Les réponses proposées par les reporters mettent toutes l’intérêt public au cœur de leurs motivations. L’intérêt public, en lien avec la pratique des journalistes, se traduit de manière transversale par la volonté de transmettre une information nuancée et claire, de façon pédagogique, afin de faire connaitre des situations, souvent injustes ou malheureuses, à un public qui ne les connaitrait pas, afin de lui permettre de se positionner de façon éclairée. Le travail journalistique permet, ou du moins prétend à donner les outils nécessaires à un débat public sain. Et d’autant plus dans des situations graves, telles que des situations de belligérance.
Pour conclure et prendre du recul sur les témoignages, il apparaît que, bien que ceux-ci mettent majoritairement en avant l’intérêt public comme motivation principale, certains aspects plus personnels, tels que le goût du risque, l’aventure ou l’aspiration à incarner l’image du reporter de guerre solitaire et téméraire, n’ont pas été mentionnés ou de façon très secondaire. Cette omission n’est pas anodine. D’une part, les journalistes interrogés expriment probablement une préoccupation sincère pour l’intérêt public. D’autre part, ce type de réponses correspond aussi à des attentes sociales. En tant que professionnels de l’information, la responsabilité sociale est une valeur essentielle, et les témoignages recueillis tendent à démontrer que cette responsabilité leur tient véritablement à cœur.
[1] Loin des lignes de front, dans les rues, etc.
[2] Accompagner une armée sur le terrain, le reporter est embarqué avec les forces militaires.
[3] Personne locale de référence pour le reporter, qui va l’accompagner dans les aspects logistiques comme le transport, la langue etc.
[4] Par ailleurs, le caméraman explique aussi courir presque plus de risques à Genève, lors de manifestations par exemple, que lorsqu’il est en terrain de guerre, le front étant bien plus prévisible qu’une manifestation, dans laquelle on ne sait pas quand la situation va dégénérer. Néanmoins les contextes de guerre de manière générale restent particulièrement imprévisibles pour les raisons susmentionnées.
Bibliographie
- Marcotte, G. (2020). L’intérêt public, l’intérêt général et l’autorégulation de la presse: analyse comparative entre la Belgique francophone et le Québec. Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Université catholique de Louvain. Prom. : Carignan, M.-È. https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/en/object/thesis%3A27628
- Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (1984). Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do. University of Illinois Press. https://doi.org/10.5406/j.ctv1nhr0v
- Rapport Hutchins (1947) A free and responsible press, The University Of Chicago Press. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.30183/page/n3/mode/2up





















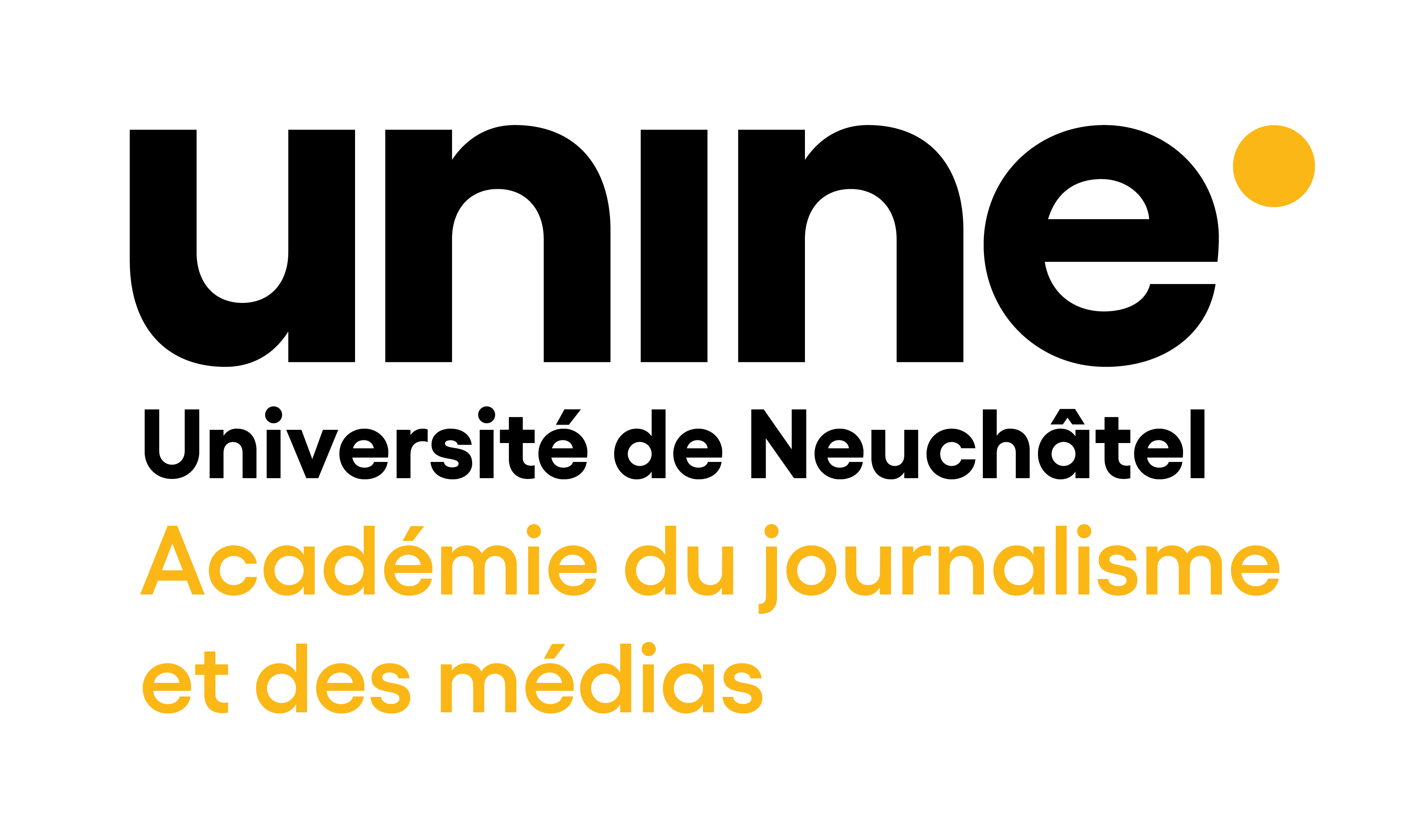

[…] текст було вперше опубліковано на швейцарському сайті EJO 6 квітня 2025 року. Українською переклала […]
Our services are designed to be effective and transparent. We focus on building a natural, powerful backlink profile for your site and driving real, engaged visitors who are interested in what you have to offer. Whether you’re looking to boost your search authority or increase conversions, Traffic Links provides the solutions you need to succeed