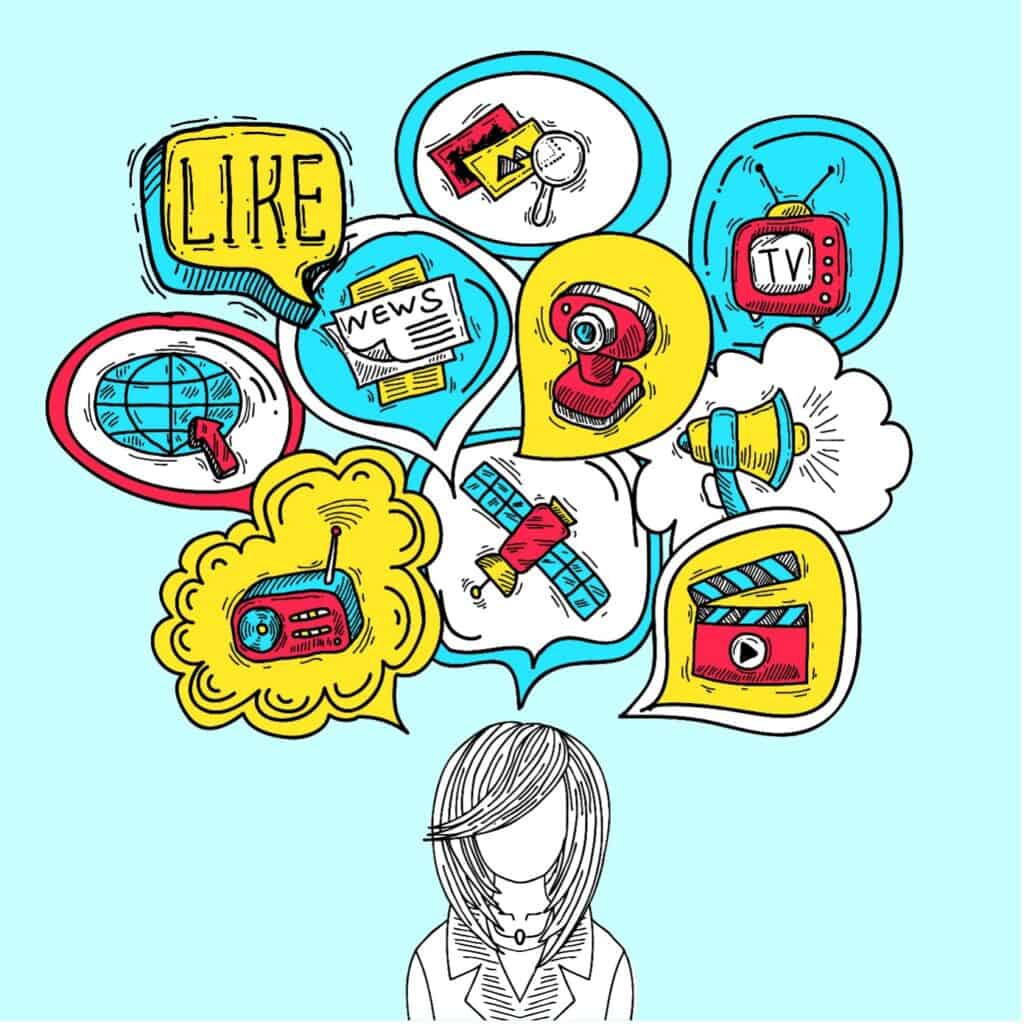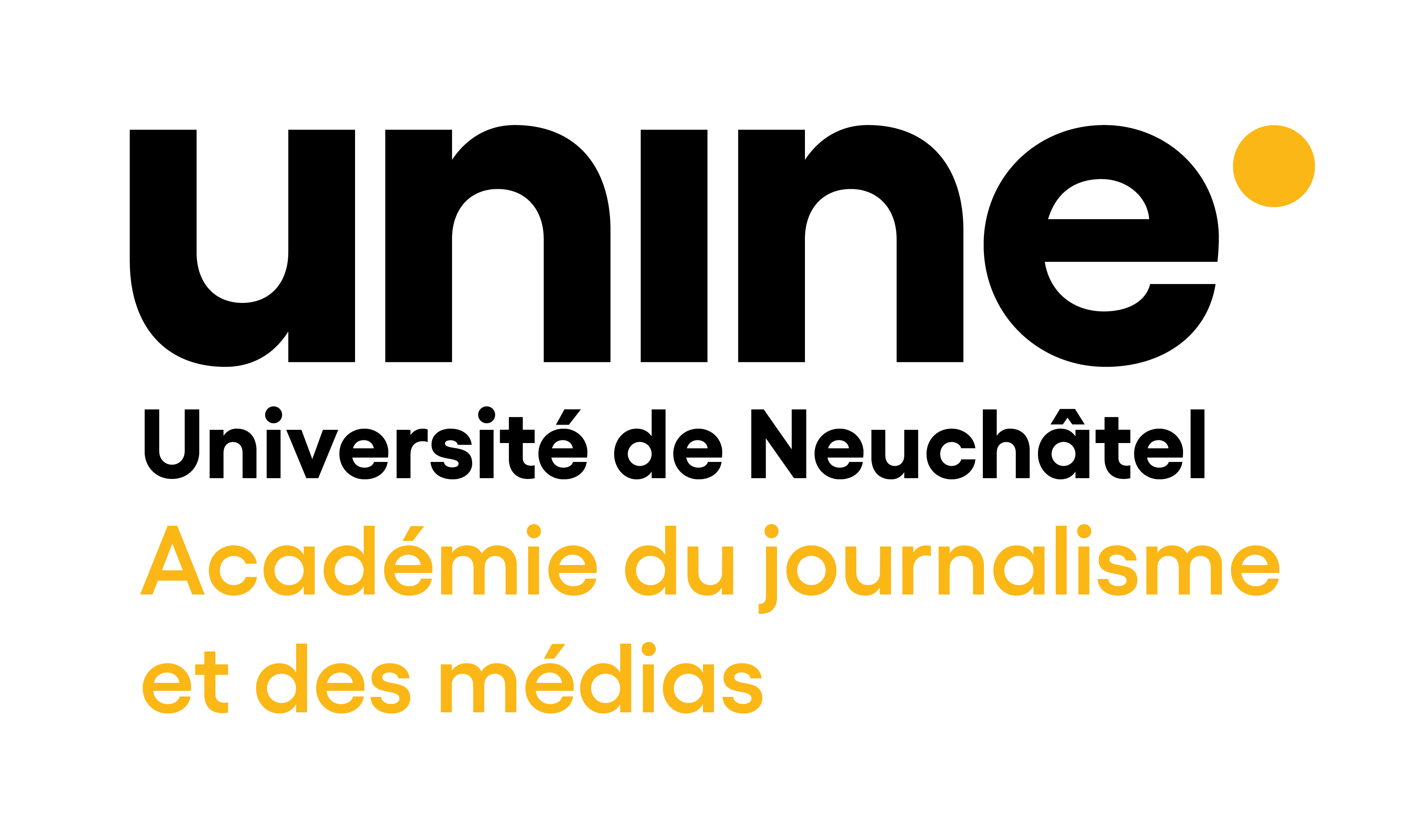Depuis une dizaine d’années, la presse romande a investi les réseaux sociaux (RS) et recrute des spécialistes, généralement formés en marketing, pour y gérer leur présence. Ces professionnels doivent faire face à des exigences journalistiques auxquelles ils n’ont pas été sensibilisés. À travers cinq entretiens semi-directifs, nous avons cherché à comprendre, dans notre mémoire de fin de master, de quelle manière quatre médias redéfinissent le rôle de chargé des réseaux sociaux.
S’adapter aux codes d’un nouveau canal de diffusion
L’analyse des métriques, la gestion des commentaires et la connaissance des algorithmes sont des compétences qui ont été fortement demandées lorsque les réseaux sociaux ont adopté une logique de monétisation et cherché à attirer le grand public autour des années 2007-2010. Constatant un virage de l’audience des canaux traditionnels (TV, radio, presse écrite…) vers le web social, les médias ont ensuite déployé leur force sur les réseaux sociaux pour diffuser de l’information (Pignard-Cheynel & van Dievoet, 2019).
Au départ, ces derniers se sont interrogés sur le ton, les formats et la ligne éditoriale à adopter. En outre, ils ont rapidement constaté qu’ils ne disposaient ni de la main-d’œuvre ni des capacités nécessaires pour diffuser l’information de manière optimale. Les spécialistes en communication, Germain et Alloing (2022), expliquent dans un article que, durant le développement des entreprises de presse sur les médias sociaux, ces dernières ont mis en place des stratégies liées à « la création d’outils d’encadrement des pratiques, l’adaptation aux outils de production et l’embauche d’experts des plateformes sociales afin de devenir des références de l’information [sur ces nouveaux canaux de communication] ».
Une fois engagés, les responsables du web social s’occupent généralement de l’adaptation et de la valorisation des contenus journalistiques. Selon les chercheuses en études du journalisme, Pignard-Cheynel et Amigo (2019), leurs actions reposent sur trois logiques (marketing, gatekeeping et participative) qui influencent l’écriture d’un post ou encore le choix des sujets à diffuser.
Une frontière floue entre marketing et journalisme
Dans le cadre de notre mémoire de fin de master, nous avons souhaité nous interroger sur ce poste hybride, à mi-chemin entre le journalisme et le marketing, afin d’identifier les défis rencontrés par ces professionnels. Pour ce faire, nous avons contacté cinq spécialistes actuellement actifs dans les médias romands. Ceux-ci expliquent qu’en intégrant leur rédaction respective, ils ont rapidement été rattachés à une cellule dédiée aux plateformes sociales qui collabore avec les autres sections de la rédaction (« team vidéo », « team print », « rédaction en chef », etc.).
Au quotidien, les responsables des réseaux sociaux utilisent des articles « faits maison » ou des contenus provenant d’autres sources journalistiques, qu’ils diffusent sous des formats adaptés aux médias sociaux. Nous avons constaté qu’ils intègrent systématiquement des considérations marketing dans leur réflexion : souhaitons-nous générer du trafic ? Gagner en visibilité ? Faire réagir les internautes ? Mesurons-nous la performance (abonnés, partages, likes…) ?
« Mais moi, j’aime justement cette mission un peu à cheval entre le journalisme et le marketing. Parce que c’est ça la diffusion. C’est de vendre des sujets, faire en sorte qu’ils soient lus. Et on a un vrai pouvoir dans la mesure où la manière dont on diffuse un sujet peut le visibiliser ou l’invisibiliser » – François Tardin, La Liberté, 2024
La performance des posts est un aspect primordial pour les techniciens des réseaux sociaux, qui s’affairent à alimenter le compte du média et à préserver sa notoriété. Pour y parvenir, ils choisissent des informations qui suscitent la réaction des internautes, dans une logique de circulation des contenus (partages, likes, liens…).
Des relations parfois tendues
Au terme des entretiens, il apparaît que ces spécialistes doivent régulièrement jongler entre les exigences de la dimension journalistique et marketing pour rester visible sur les réseaux sociaux (loi des algorithmes, référencement, etc.). Afin d’y parvenir, ils adaptent leur écriture (formulations incitatives), modifient les articles (réduction du texte, changement de mots, etc.) et choisissent les formats (capsules vidéo, carrousels, etc.).
Cependant, ces ajustements ne sont pas toujours perçus favorablement par les journalistes des différentes rédactions. Ceux-ci reprochent aux responsables des médias sociaux de dénaturer le sens du texte (ex. : manque de contexte) ou d’outrepasser les règles fixées par la déontologie du journalisme (diversité des points de vue, objectivité, etc.). Les mécontentements se traduisent par une nette distinction de statut entre les deux métiers :
« J’ai compris que pour que je sois légitime, notamment à retravailler un titre, je dois avoir une formation de journaliste. Clairement, si vous ne l’êtes pas, [les autres journalistes de la rédaction] ils vont vous prendre de haut, ils vont me dire : tu es qui pour changer mon titre ? […] il y a clairement une distinction entre les statuts. Les mecs du web, on passe un peu pour les guignols. » – François Tardin, La Liberté, 2024
Laetitia Béraud au Temps fait part de la même problématique au sein de sa rédaction. Elle explique que des conflits éclatent parfois entre les collègues :
« On ne va pas se mentir, il y a des gens dans la rédaction qui sont ce qu’ils sont, et avec lesquels, c’est plus ou moins facile de travailler. Il y en a qui sont pointilleux et d’autres moins. D’autres qui comprennent que les RS, on est obligé de faire plus court ou de formuler autrement. Et certains, si tu enlèves une virgule, c’est la fin du monde […] » – Laetitia Béraud, Le Temps, 2024
La majorité des participants à nos entretiens rapporte qu’il est courant que les recruteurs recommandent aux chargés des RS d’effectuer une formation en journalisme pour éviter les bisbilles et préserver la ligne éditoriale du média sur les plateformes sociales.
« [Une de nos collègues], il y a cinq ans, a été engagée comme Community Manager. Entre son travail du jour 1 jusqu’à maintenant, il est devenu de plus en plus journalistique. On a senti naitre de plus en plus le besoin d’avoir des profils journalistiques à ces postes-là. Actuellement, on n’engage plus que des journalistes ou des gens qui souhaitent le devenir. » – Jérémy Rico, La Liberté, 2024
Dans le cadre de cette étude, toutes les personnes interviewées réalisent que les postes réservés aux réseaux sociaux sont occupés par des individus qui possèdent un rôle « à cheval entre le marketing et le journalisme » (Tardin, La liberté, 2024).
Ces derniers n’ont pas d’autre choix que de s’aligner aux normes des plateformes sociales pour conserver une certaine visibilité : reformulation de la titraille, choix du format, sondages, stories etc. Toutefois, pour conserver l’image de marque du média (réputation, recherche de la vérité, chien de garde de la démocratie…) et éviter de virer dans le métier de la communication, certains intervenants expliquent que les chargés des RS ajoutent une formation en journalisme à leur CV.
« L’avantage dans l’équipe, c’est qu’on a des compétences complémentaires […] C’est là aussi que ça sert peut-être, sans m’envoyer des fleurs, d’avoir une journaliste à la tête des RS. C’est que moi, je peux aussi avoir cette discussion avec le journaliste et plus facilement leur dire pourquoi on a choisi une info plutôt qu’une autre, pourquoi on a changé son titre ou son texte d’une certaine façon. » – Laetitia Béraud, Le Temps, 2024
Cette double casquette permet de créer un pont entre les deux métiers au sein d’un média et assurer un travail journalistique de qualité. Avec ce mélange des genres (communication, journalisme et marketing), nous pouvons nous interroger sur la nécessité de voir naitre une formation spécifique au journalisme destiné aux réseaux sociaux, à l’image du Centre français de formation et de perfectionnement des journalistes qui propose des cours sur les stratégies éditoriales et la production de contenus pour les RS.
Bibliographie
NEILSON, Tai & GIBSON, Timothy A. (2022). Social media editors and the audience funnel : Tensions between commercial pressures and professional norms in the data-saturated newsroom. Digital Journalism, 10(4), pp.556-578.
GERMAIN, Sara & ALLOING, Camille. (2022). Engager, cliquer, liker. L’éditorialisation des contenus journalistiques sur les plateformes numériques. Quaderni, pp.19-38.
PIGNARD-CHEYNEL, Nathalie & AMIGO, Laura. (2019). Le chargé des réseaux socio-numériques au sein des médias : entre logiques gatekeeping, marketing et participative. Réseaux, 1(213), pp.139-172.
PIGNARD-CHEYNEL, Nathalie & VAN DIEVOET, Lara. Journalisme mobile : Usages informationnels, stratégies éditoriales et pratiques journalistiques. De Boeck Supérieur, 2019.
Cet article est publié sous licence Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Il peut être republié à condition que l’emplacement original (fr.ejo.ch) et les auteurs soient clairement mentionnés, mais le contenu ne peut pas être modifié.
Cet article est tiré du mémoire de fin de Master de Yann Girard, ancien étudiant à l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel.
Tags: réseaux sociaux, Social media, Social Media and Newsrooms, social media editor