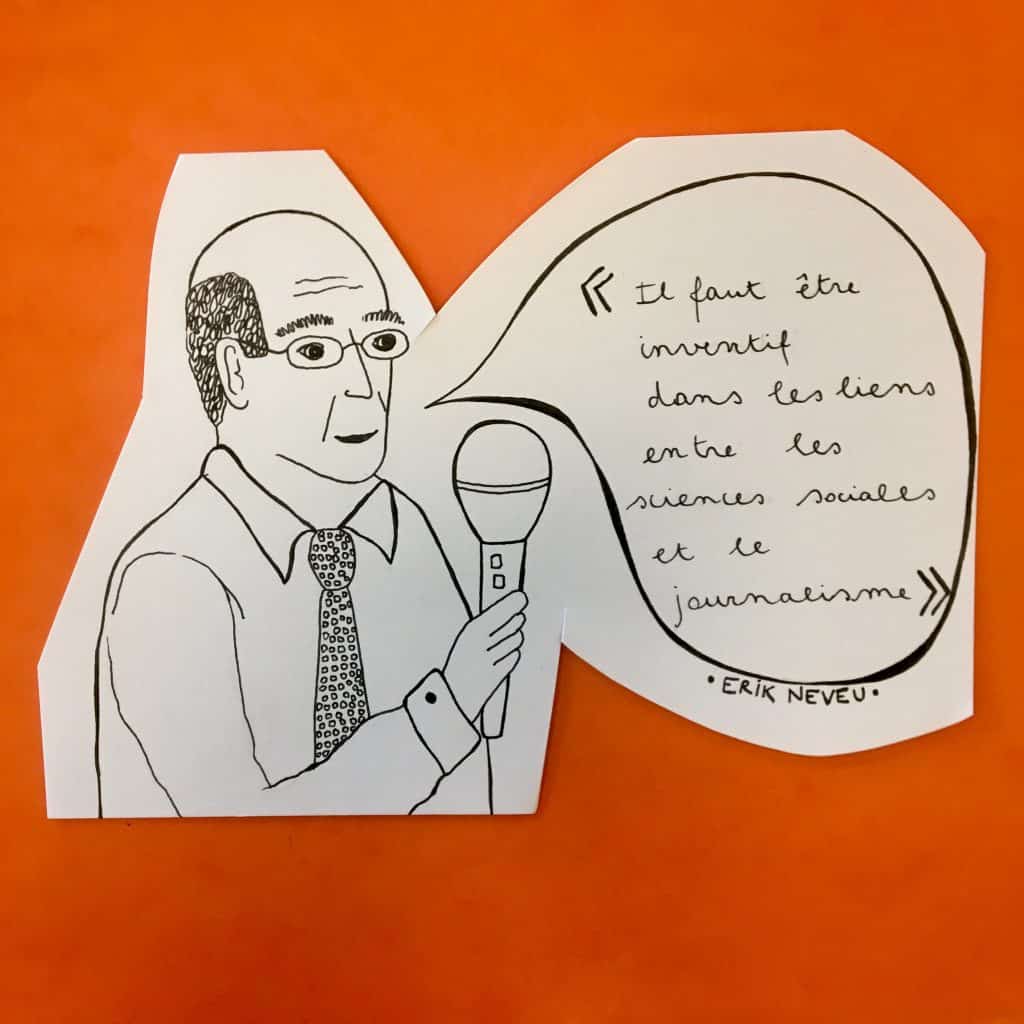Expliquer ou légitimer ? Prendre du recul ou défendre ? La question de la réflexivité dans un métier en pleine zone de turbulence a occupé les intervenants à la journée des 10 ans de l’Académie du journalisme et des médias. Sociologue et politiste, le prof. Erik Neveu s’est exprimé sur les enjeux qui entourent la nécessité d’expliquer le journalisme tout en évitant la posture professorale. Il défend notamment l’importance d’aménager les conditions cadre à l’exercice de l’autoanalyse dans les médias pour inventer le journalisme de demain. Il reproduit ici une version écrite de son allocution.
Comment les journalistes racontent-ils leur travail tout en le faisant ? J’ai été invité à m’exprimer sur cette question par l’Académie du journalisme et des médias de Neuchâtel. Pour y répondre, il m’a fallu faire un détour. Les universitaires, de leur côté, racontent-ils leur travail tout en le faisant ? Si la question est de savoir s’il est courant chez les universitaires de réfléchir à son métier, de mettre ses pratiques en débat entre soi, avec les étudiants, vers un large public, de savoir si l’autoanalyse est une posture permanente, la réponse est, hélas, négative. Elle n’est le régime quotidien d’aucune vie professionnelle.
« Nous sommes empiriques dans les trois quarts de nos actions » (Leibniz)
Pourquoi ce hors-piste ? Pour deux raisons. Premièrement, même dans ce qui se met en scène comme le temple de la réflexivité, l’université, on ne réfléchit pas tant que cela, on ne déploie pas régulièrement un art de la pensée critique. Par pensée critique, j’entends la visée bien difficile de conjuguer deux choses. La première est de comprendre, au sens de « se mettre à la place de », les raisons qu’ont les autres ou nos proches de faire ce qu’ils/elles font même quand cela nous choque ou étonne.
La seconde est d’expliquer au sens d’identifier des causes, des écheveaux d’interdépendances qui rendent compte des croyances, des comportements, de la nature de nos marges de manœuvre. Ecrivons-le simplement : il ne suffit pas de se dire intellectuel ou d’avoir « professeur » écrit sur sa fiche de paie pour bien pratiquer cette réflexivité critique au quotidien.
Dans une formule souvent citée par Bourdieu, Leibniz dit, et c’est la seconde raison de mon détour, que « nous sommes empiriques dans les trois quarts de nos actions » (pourcentage à mon sens encore sous-estimé). Qu’entendre par là ? Que nous pouvons être merveilleusement intelligents et efficaces sans réfléchir, parce que nous avons littéralement « fait corps » des opérations d’analyse, de traitement de tâches et que cela fonctionne souvent de façon satisfaisante ou même virtuose.
Dans un classique de la sociologie du journalisme, Herbert J. Gans [1] raconte comment – c’était à la fin des années 70 – il voit dans une rédaction les journalistes trier avec promptitude et sûreté les dépêches qui s’impriment sur le télex, identifier celles qui vont droit à la corbeille, et celles qu’on récupère comme un talisman pour aller préparer un papier. C’est qu’ils ont incorporé par formation et apprentissage, essais et erreurs un sens de la newsworthyness, de la valeur d’information, qu’elles et ils ont un « flair » sur ce qui fera la bonne actu ou le récit qui marque.
Tout conspire à nous priver du temps du recul
Demandez-moi à brûle pourpoint comment on écrit un article scientifique et je commencerais à bafouiller…mais j’en produirais un, sans doute acceptable, en peu de temps si j’ai les munitions pour cela. Si nous sommes « pratiques » la plupart du temps, c’est à dire hors réflexivité explicite, c’est aussi que dans bien des métiers tout conspire à nous priver du temps du recul, de l’émancipation de l’urgence. C’est là quelque-chose que les journalistes connaissent bien.
Être englués dans la pratique c’est le lot de toutes celles et ceux qui vivent sous la pression constante du flux tendu, des rapports à rendre, du trop de choses à faire, des deadlines. Si nous sommes « pratiques », c’est aussi que la réflexivité ouverte peut nous amener à devoir exhumer les dirty little secrets d’une activité, ceux qu’on n’aime ni avouer, ni s’avouer.
Si nous sommes « pratiques », c’est encore que la division sociale des tâches consiste trop souvent à faire comprendre à ceux qui sont à un échelon n-1 que réfléchir c’est la chose de ceux du niveau n ou n+. Si nous sommes « pratiques », c’est encore qu’en situation normale, dans le business as usual, les choses marchent en quelque sorte en pilotage automatique, et que les savoirs incorporés incluent jusqu’à la gestion de l’urgence, jusqu’à apprivoiser l’imprévisible et le dangereux.
Souligner tout cela ne signifie pas que, journalistes ou universitaires, nous ne passions pas en des régimes de réflexivité plus explicite quand les circonstances l’imposent. Cette bascule s’opère quand les routines ne fonctionnent plus, quand des tensions ou des échecs deviennent perceptibles dans la mise en œuvre des dispositions et modes d’emploi incorporés.
La bonne vieille formule « écrire pour son lecteur » a été rabâchée par les écoles de journalisme, érigée en un de ces « ce qui va de soi » auquel on ne réfléchit plus – sauf quand les ventes de quotidiens papier commencent à s’effondrer, quand les études montrent la désertion croissante du lectorat lycéen ou étudiant… on nomme alors ici un chargé de mission pour comprendre comment reconquérir un lectorat jeune, on remet en discussion ce que seraient les attentes des lecteurs ou auditeurs…
Crise de la presse, du journalisme et du rapport aux publics
Le journalisme est confronté, souvent avec brutalité, à cette rupture que Michael Delli Carpini et Bruce Williams [2] ont pertinemment systématisé comme l’équivalent d’un changement de régime dans l’ordre politique. Il fait face à une érosion majeure de ses ressources financières encore aggravée par la répugnance d’une part croissante du public jeune à payer pour accéder à des informations.
Les journalistes se voient concurrencés par des troupes plus nombreuses de producteurs d’informations, professionnels ou non, qui peuvent être les chargés de com et P.R.O. d’entreprises, de lobbies, de forces politiques, mais aussi des blogueurs, usagers de réseaux sociaux, sites web divers.
La crise du journalisme est tout autant une crise de la croyance, de l’illusio de Bourdieu. Elle s’observe du coté de nombreux publics où la confiance dans les journalistes et les médias s’érode. Elle existe aussi dans la profession journalistique elle-même de plus en plus phagocytée par la logique de la communication. Ce sont aussi la précarité institutionnalisée, le manque de temps et de moyens pour le terrain et l’enquête, l’urgence décuplée par la mise en ligne, le suivisme éditorial qui provoquent démoralisation ou rapport plus cynique au travail.
Le diagnostic est rapide, incomplet. Mais l’existence d’une crise qui est à la fois celle de la presse, du journalisme et de leurs rapports à des publics ne fait pas de doute. Elle apparaît à l’immense majorité des journalistes à la fois comme une expérience déstabilisante, un fait objectif et un défi.
S’expliquer, s’exprimer, se définir
Il m’a toujours semblé depuis que j’ai produit un ouvrage de synthèse et de vulgarisation sur la sociologie du journalisme [3] que la meilleure critique (au sens de comprendre et expliquer) du journalisme comme activité n’était pas dans la dénonciation de tel praticien ou de telle dérive, mais dans l’explication précise des conditions dans lesquelles travaillent les journalistes.
Quelle est leur formation, leur trajectoire sociale ? Dans quels systèmes hiérarchiques sont-ils/elles pris ? Quelle peut être l’influence des propriétaires de médias et comment s’exerce-t-elle ?
Quels effets engendrent des conventions de définition de ce qui fait information, des patrons d’écriture ? Que valorise t’on et qu’occulte-t-on quand on couvre les politiques publiques en analysant leur naissance et les effets des rapports de force partisans dans celle-ci mais bien moins souvent leur mise en œuvre, leurs effets sur les publics cibles, ou en amont le rôle des lobbies ? La bienséance syntaxique qui dissuade la presse américaine d’employer le vilain mot de torture pour caractériser ce qui se passe à Guantanamo n’est-elle qu’un enjeu littéraire?
Plus essentiellement quelles sont les relations d’interdépendance avec des sources souvent capables d’anticiper sur les impératifs du travail des journalistes ? Quelles images se font les divers journalistes de leurs publics, de leur capacités et attentes ?
Si les journalistes du service sportif de France 2 ont en effet trouvé au sein même de leur rédaction des collègues d’une cellule d’investigation plus audacieux qu’eux, pour dénicher dans les poubelles d’une équipe de drôles de seringues et des produits dopants, ce n’est pas qu’être journaliste sportif prédestine à l’absence de curiosité, c’est que dénoncer sur le mode du scoop une affaire de dopage revient à se couper des liens avec beaucoup de coureurs, déstabilise la couverture d’un événement symboliquement et financièrement essentiel pour sa chaîne.
Si, à l’inverse, les journalistes de So Foot peuvent lancer un magazine irrévérencieux, décalé et rigolard qui sort de la célébration et de la complaisance pour les vaches sacrées du football, c’est qu’ils ont un profil assez différent, visent un public nouveau et qu’ils font le pari d’un mode de traitement qui fait l’impasse sur les propos souvent convenus des entraîneurs et vedettes [4].
Éclairer le travail journalistique : «ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais »
Pour reprendre la question de départ sur la réflexivité des journalistes, une posture qui combine réflexivité sur sa pratique et pédagogie vers les publics est bien de rendre intelligible « ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais ».
Pour ne citer que quelques exemples, une série de papiers, puis un livre du journaliste Philippe Ridet [5], chargé de « couvrir » Nicolas Sarkozy pour Le Monde durant et après la présidentielle de 2007, constituent des modèles à la fois de réflexivité sur l’exercice du métier et de pédagogie pour en faire sens à un public plus large. Il y aborde les jeux de séduction, d’instrumentation, de don et de contre-don dans lesquels est inévitablement pris un journaliste politique.
La synthèse de Dean Starkman, ancien journaliste du Wall Street Journal, justement intitulée « Le chien de garde qui n’aboyait pas »[6], rend admirablement compte du pourquoi et du comment des modes de définition de l’information économique solvable sur le marché de la presse, de l’inégalité des rapports de force entre sources et journalistes, de leur connivence épistémique dans une foi quasi religieuse dans les vertus du capitalisme financiarisé …tout cela produisant une information largement acritique, utilitariste à court terme pour les acteurs de la finance.
Les émissions où Élise Lucet rend visible à l’écran les obstructions, manœuvres ou intimidations de ses cibles sont une autre façon d’éclairer le travail journalistique « in progress ». On peut encore souligner sur ce registre l’intérêt d’une série de sites web, comme Arrêt sur images de Daniel Schneiderman, où des journalistes ou anciens journalistes se dédient à un travail d’analyse des modes de construction de l’actualité, de définition et de traitement des enjeux.
Sur un mode un peu différent, il faut encore relever l’essor de rubriques, sites ou programmes visant à démonter les « fake news », à rappeler les conditions de production d’une information recoupée (Desintox dans Libération ou le 28 minutes d’Arte, le Checknews de Liberation ou le Decodex du Monde).
Toutes ces initiatives sont précieuses si elles permettent de comprendre les procédures et compétences qui produisent une information fiable, de rendre intelligible le professionnalisme du travail journalistique. Elles ont aussi l’ambiguïté de suggérer que le journalisme détient en quelque sorte un monopole de l’information légitime ou exacte, ce qui est factuellement faux et subjectivement irrecevable pour beaucoup.
Combiner pluralité des formats et des narrations
Une autre façon, pratiquée plus que théorisée ou expliquée, de combiner réflexivité professionnelle et pédagogie de la rigueur serait de rendre intelligible combien le journalisme ne peut déployer tous ses apports qu’en combinant une pluralité de formats et de modes de narration. C’est là un point bien mis en lumière par un récent travail du sociologue Rod Benson sur la couverture de l’immigration en France et aux USA [7]. Faire sens d’un dossier ou d’un événement, c’est combiner à la fois des informations hyper-condensées, brèves et très synthétiques et la production d’un motif d’ensemble par une mosaïque de contributions.
Comprendre et expliquer l’immigration, c’est mobiliser des chiffres digérés par une bonne infographie, produire des cartes, interviewer des experts, des élus et des responsables associatifs. C’est encore solliciter le témoignage des migrants eux-mêmes, partager leur expérience sous la forme du reportage comme le fit le journalise Ted Conover [8] pour les migrants mexicains aux USA ou Frank Genauzeau de France 2 [9].
Comme le compositeur de musique sait combiner les divers « pupitres » d’instruments pour produire une belle œuvre, il s’agit de jouer à la fois du reportage, de la sollicitation d’experts et de décideurs, du témoignage des migrants et de ceux qui agissent avec eux sur le terrain. On peut ainsi approcher de ce que Gans appelle une « information multiperspective ». Elle n’est ni objectivité, ni vérité à majuscules mais effort pour rendre intelligible la diversité des points de vues et des vécus sur un fait social.
Faire le ménage dans ses propres rangs : les éditorialistes
Le souci pédagogique des journalistes s’exprime encore dans la volonté de faire comprendre en quoi « d’autres que moi, qui n’ont ni mes compétences, ni mes méthodes, ni ma formation, ne peuvent le faire aussi bien en se passant totalement de moi ? ». En soulevant un problème qui risque de faire tousser dans les rédactions et peut être les « académies » de journalisme, ce nécessaire travail de démarcation ne devrait-il pas commencer par faire ce ménage dans ses rangs ?
Formulons une hypothèse sacrilège : et si, en France, une large part du discrédit qui frappe – non sans bonnes raisons – le journalisme aujourd’hui venait d’une catégorie particulière de la profession, remplissant impeccablement les conditions pour bénéficier de la « carte » : les éditorialistes ?[10]
Quand on parle des « journalistes », le grand public pense au premier chef aux plus visibles d’entre eux : présentateurs de JT et éditorialistes multicartes passant de plateau télé en tribunes et interviews. Ils et elles peuvent être brillants dans l’expression, provocateurs, vifs. Ils et elles ont aussi en commun de s’exempter généralement de ce qui est l’opération fondatrice du travail journalistique, soit la collecte d’informations originales.
Un obscur éditorialiste de BFM – dont on ne signale pas qu’il fut l’auteur de travaux d’économie nobélisables – n’a-t-il pas traité les 20% de votants pour Mélénchon d’ « abrutis »[11] ? On imagine les vocables adressés à ceux, plus nombreux, qui ont voté Front National…
On ne proposera pas ici l’éradication des éditorialistes. Mais peut-être y a-t-il un coûteux paradoxe à ce que les professionnels des médias les plus visibles, perçus comme les illustrations du « journalisme », aient une double propriété : n’être les auteurs d’aucune contribution à l’avancée des savoirs ou des arts, et se trouver émancipés d’une série des valeurs centrales du journalisme, comme le travail d’enquête et de terrain, le souci de rendre intelligible avant de juger, la spécialisation sur un objet ou une activité qu’on peut raisonnablement maîtriser.
Peut-on faire la modeste proposition, qui préserverait leur droit de parole, qu’à l’instar de l’Auguste des spectacles de cirque, un maquillage blanc craie spécial ou le port d’un nez rouge sur les plateaux signale pédagogiquement, vis à vis de leurs pairs et des publics, qu’il y a là une espèce bien particulière de journalistes ?
Quand il ne suffit pas d’expliquer : l’illusion pédagogique.
Rendre intelligible la logique et les opérations, les difficultés et les réussites du travail journalistique en train de se faire constitue assurément une réponse à la crise de crédibilité de la profession et à l’inflation des nouvelles peu fiables ou des délires promus évidences. La limite de la démarche tient à ce qu’elle peut aboutir à bricoler une poursuite du journalism as usual.
Comme si…le succès des « fake news » ne devait qu’à la crédulité du public populaire. Comme si …une information produite selon les règles de l’art par des journalistes constituait une approche optimale de quelque chose qui se nomme le réel, ou simplement d’une connaissance adéquate des intérêts et attentes des publics. Comme si …l’essor des réseaux sociaux, la scolarisation croissante, la production de data transformables en nouvelles n’avaient pas radicalement changé l’écologie même de la production et diffusion de l’information.
Penser qu’il suffit de mieux expliquer ce qu’on fait et comment on le fait mieux que d’autres, revient à s’agripper à un magistère dont les conditions de possibilité sont objectivement défaites. Ce peut aussi être revendiquer ce qu’il y a de plus agaçant dans la prétention des diverses tribus intellectuelles face aux profanes : une certitude de surplomb, une posture professorale qui ne passe plus.
Une première limite de l’illusion pédagogique est de ne pas toucher à l’un des points aveugles de la réflexion du groupe : la sociologie des journalistes. Il n’y a pas de prédestination sociale, et la capacité à se rendre perméable à l’altérité peut s’apprendre. Mais on peut s’étonner que les façons de définir les informations pertinentes, de les cadrer et de les mettre en récit suscitent le scepticisme, l’agacement ou l’indifférence de publics fort divers quand on constate – en France, mais pas seulement – l’homogénéité des journalistes qui accèdent aux positions de visibilité et de rayonnement (au Monde et a BFM ou L’Obs plus qu’à Var-Matin, Science et vie micro ou France Bleu Berry).
Les journalistes, en France en tout cas, sont massivement issus des classes supérieures à fort capital culturel. Leurs parcours scolaires sont homogènes avec une large place des Instituts d’études politiques et des facultés d’histoire. Leur expérience de l’altérité est, sauf rares cas de mobilité sociale ascendante, faible ou limitée à une année Erasmus [12].
Leur culture familialement ou scolairement acquise est rarement hérétique. Rares sont dès lors les articles qui suivent des politiques publiques ou des réformes du point de vue de leurs effets concrets sur leurs destinataires ordinaires. Pas si fréquents sont les reportages qui, sans tomber dans la complaisance ou le misérabilisme, portent un regard empathique sur les milieux populaires [13], sur ceux qui dépendent des minima sociaux, votent pour des formations « extrémistes ».
Retrouver des publics perdus, convaincre que le journalisme peut aider chacun à comprendre le monde où il vit requiert de parler et écouter autrement, de parler d’autre chose. Et cela demande aussi de questionner le recrutement social des journalistes, de valoriser dans leur formation et leur sélection le talent d’empathie, les savoir-faire d’une immersion dans une pluralité de mondes sociaux.
Sécuriser le journalisme par l’explication : l’apport des sciences sociales
Il est clair que tout n’est pas ici affaire de pédagogie. « Expliquer » demande du temps, des budgets, de ne pas être en butte à des institutions et des sources puissantes qui menacent, poursuivent, intimident. L’observation est banale. Elle prend aussi une actualité singulière quand de plus en plus de rédactions sont financièrement exsangues, « dégraissées » d’une part de leurs effectifs, et que croît le nombre des entraves, des poursuites et des secrets divers opposés aux enquêteurs.
Pour parvenir à expliquer non seulement ce qu’ils font ou n’arrivent plus à faire, les journalistes ont, dans ce contexte, besoin de voir leur activité sécurisée par de nouveaux dispositifs de financement, des garanties juridiques qui les protègent et fassent payer très cher les tentatives de museler le droit d’enquête.
Une des réponses à la crise se trouve dans la mobilisation des travaux, des concepts et des chercheurs en sciences sociales, même si, pour de multiples raisons, la synergie entre sciences sociales et journalisme peine encore à porter ses fruits. Il ne s’agit ni de faire des chercheurs les mentors des journalistes, ni de faire du journalisme une version grand public de la sociologie, mais d’observer que le dialogue et la fréquentation mutuelle peuvent produire des bonus d’intelligibilité sur ce terrain de l’explication.
Pour en citer deux illustrations fort différentes, le sociologue Cyril Lemieux avait montré dans une série de chroniques de France-Culture [14] comment il était possible d’aller chercher dans les concepts les plus théoriques des sciences sociales une petite boite à outil pour éclairer l’actualité. Les entretiens de Robert Boynton [15] avec les figures du new-new journalism aux USA montrent leur connaissance ou leur mobilisation des travaux de science sociale. Dean Starkman relève avec un certain humour le fait que les très rares journalistes qui avaient mis en garde sur la possibilité d’une crise financière majeure avant 2008 étaient en plusieurs cas les titulaires de thèses de science sociale sur des objets bien éloignés de la finance. Bref, les travaux de sciences sociales peuvent avoir des usages plus pratiques que de mâcher du concept.
A nouvelle écologie de l’information, nouvelles pratiques
Last but not least, on peut emprunter à l’ethnographe C.W. Anderson [16] la notion d’« écologie de l’information ». Pour le dire en peu de mots, à peu près tout ce qui avait imparfaitement stabilisé un système de production et diffusion de l’information s’est défait. Le « nouveau » est partout : dans la nature des médias, des formats, des acteurs dans les pratiques des publics, les formes du gate-keeping.
A nouvelle écologie, nouvelles pratiques. Une part du travail journalistique – ce qui ne veut pas dire de tous les journalistes – est désormais de fonctionner dans ce que le sociologue Bruno Latour pourrait décrire comme des stratégies de « traduction », de mise en réseau. Il s’agit d’identifier des producteurs d’informations fiables dans tel périmètre précis, d’aller ici pomper des datas et savoir les traiter, là de donner écho à des informations ou des données déjà synthétisées par d’autres, là encore de faire barrage à une offre d’information qui ne soit que l’émanation de lobbies.
Orchestrer c’est encore mobiliser audiences et réseaux, sans se laisser aller aux nouvelles mythologies d’Internet sur la « wisdom of the crowds » qui voudraient que toute délibération ou élaboration collective soit plus juste encore que la « volonté générale » chère au genevois Jean-Jacques Rousseau, comme sut le faire le Guardian pour faire ouvrir par les internautes des milliers de documents comptables du parlement britannique et prendre la main dans le pot de confiture quelques élus indélicats.
Orchestrer et réseauter c’est encore passer, dans des conditions mutuellement respectueuses, des accords avec des écoles de journalisme pour apporter du contenu, passer par des plates-formes de crowdfunding pour mobiliser le financement de reportages ou d’investigations au long cours.
Une dernière remarque sur cette notion d’écologie. Utiliser ce terme pour penser la transformation radicale des conditions de production et de diffusion de l’information semble une métaphore féconde pour les raisons esquissées plus haut. Il faudrait aussi réfléchir à ce qu’est une écologie de la réflexivité. Les moments de crise et de rupture en sont des catalyseurs. Mais il faudrait aussi prendre en compte la manière dont une profession se dote tant en « interne » que dans ses relations avec d’autres mondes sociaux des outils d’une confrontation des idées.
Mettre en discussion des pratiques et des expériences
Existe-t-il des lieux de rencontre institutionnalisés liés à des groupes de presse, des syndicats, des rituels professionnels ? La profession est-elle dotée d’une presse qui soit un lieu de mise en discussion des pratiques et expériences, au-delà de la défense – nécessaire – de revendications corporatistes ? Des systèmes de « prix » et de récompenses viennent-ils marquer des réussites, sont-ils attribués au terme d’une compétition ouverte, attentive à la diversité des formes du journalisme ?
Des espaces de rencontre permettent-ils une discussion relativement sereine et mutuellement respectueuse entre journalistes d’une part, chercheurs ou groupes ayant des rapports plus militants à la production d’information, d’autre part? Des formes de coopération sont-elles organisées comme de faciliter l’accueil des chercheurs dans les rédactions, symétriquement de proposer à des journalistes, via des fondations ou du mécénat, des bourses ou financements sabbatiques pour mener à bien des reportages exigeants, se lancer dans une formation ?
Créer des oppositions binaires c’est souvent forcer le trait. Mais il est cependant visible que la plupart de ces données « écologiques » existent par exemple en grande Bretagne, plus encore aux USA (on citera pêle-mêle la Columbia Journalism Review ou Press/Politics, les prix Pulitzer, les systèmes de grants dont peuvent bénéficier des reporters, une facilité des discussions entre journalistes et universitaires qu’attestent des volumes issus de séminaires partagés faisant le bilan d’une campagne électorale et de sa couverture par exemple).
Le journalisme vit aujourd’hui un moment dramatique et merveilleux, terrifiant et prometteur où beaucoup est à réinventer, où l’heure est, pour revenir au point de départ, à la réflexivité : pour inventer de nouveaux formats de traitement de l’information, redéfinir ce qui fait les « nouvelles », renouer un autre rapport aux publics. Qu’en est-il en Suisse, en France ?
Notes
[1]Herbert J. Gans, Deciding What’s News, Vintage, New-York, 1980.
[2]Bruce Williams & Michael Delli Carpini, After Broadcast News: Media Regimes, Democracy, and the New Information Environment,. Cambridge University Press, Cambridge,MS, 2011.
[3]Erik Neveu, Sociologie du Journalisme, la Découverte, Paris, 1° Edition 2001, 5° edition prévue pour 2019.
[4]Que la réussite du titre amène au bout de quelques années à se prêter au jeu des entretiens… décalés…ou moins imprévisibles à mesure que le magazine gagne de la légitimité ?
[5]Philippe Ridet, « Ma vie avec Sarko », Le Monde, 20 février 2007 (équilibré d’un « Ségo et moi » de sa consoeur Isabelle Mandraud le 21 Février), Le Président et moi, Albin Michel, Paris, 2008.
[6]Dean Starkman, The Watchdog that did’nt bark, Financial Crisis and the Disappearance of Investigative Journalism, Columbia Journalism review books, New-York, 2014. Books, New-York, 2014.w Books, New-York, 2014.
[7]Rod Benson, Shaping Immigration News. A French American Comparison. Cambridge University Press, 2014 Trad Française, L’immigration au prisme des médias, PUR, Rennes, 2017.
[8]Ted Conover, Coyotes, Vintage, New-York, 1987.
[9]https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-ce-qui-m-a-marque-c-est-la-gentillesse-des-gens-sur-le-bateau-temoigne-franck-genauzeau-qui-a-filme-sa-traversee-vers-la-grece_1084965.html
[10]Brocardés dans deux volumes des « Editocrates » par Olivier Cyran et Sébastien Fontenelle, (La decouverte 2009 et 2018)
[11]https://www.marianne.net/politique/video-eric-brunet-de-bfmtv-traite-les-electeurs-de-melenchon-de-19-d-abrutis
[12]Pour une analyse chiffrée de ces tendances sur le cas français voir Geraud Lafarge et Dominique Marchetti, «Les portes fermées du journalisme. L’espace social des étudiants des « formations reconnues »», Actes de la recherche en Sciences Sociales, n°189, 2011, pp 172-189.
[13]On peut penser au «Nickel and Dimed» de Barbara Ehrenreich aux USA et son pendant du «Quai de Ouistreham» par Florence Aubenas coté Français, aux efforts de Jean-Baptiste Mallet pour raconter dans « En Amazonie » les conditions de travail chez Amazon
[14]Cyril Lemieux, La Sociologie sur le vif, Presses des Mines, Paris, 2010.
[15]Robert Boynton, The New new Journalism. Conversations with America Best Non-Fiction Writers on their Craft, Vintage, New York, 2005.
[16]Rebuilding the News: Metropolitan Journalism in the Digital Age, Temple University press, 2013.
Tags: AJM, crédibilité, crise, éducation aux médias, erik neveu, journalisme, nouveaux formats, pédagogie, public, réflexivité, sociologie