Dans une ère où l’actualité est omniprésente, la recherche scientifique s’est intéressée à la surcharge informationnelle des consommateurs. Mais qu’en est-il des professionnels de l’information qui sont quotidiennement connectés ? Enquête auprès de 171 journalistes en Suisse romande, qui explore les perceptions, les impacts et les stratégies de gestion face à une surcharge informationnelle liée au métier.
La surcharge informationnelle – aussi appelée fatigue informationnelle ou infobésité – est un phénomène caractérisé par une surcharge cognitive due à un excès d’information (Eppler & Mengis, 2004). Elle est amplifiée par le développement des nouvelles technologies. Bien que touchant différents secteurs, peu d’études s’intéressent à l’effet de la surcharge informationnelle sur les journalistes, dont le métier repose justement sur le traitement intensif des informations. C’est pourquoi, dans le cadre de notre mémoire de fin de master en journalisme, nous avons décidé d’étudier la relation de ces professionnels avec l’information et les stratégies utilisées pour prendre soin de leur santé mentale, ainsi que de l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.
Une littérature incomplète voire inexistante
La littérature existante discute largement l’effet de la surcharge informationnelle sur les consommateurs. Cependant, elle ignore en majeure partie les journalistes. Ces derniers, en tant que producteurs et consommateurs d’informations, font face à une pression accrue en raison de l’augmentation des canaux de diffusion et de la nécessité de réagir en temps réel pour être performants. Ce contexte de surcharge informationnelle n’est pas sans lien avec la manière dont les journalistes perçoivent leur métier, souvent considéré comme un métier de « sacrifices » et de « passion » (Bouron et al., 2017). « Cette passion pour le métier dévore la vie privée », résument Devillard et Le Saulnier (2020, p.94). La perception que les journalistes ont de leur métier entraîne souvent une limite presque inexistante entre la vie professionnelle et la vie privée, ce qui exacerbe les risques de surcharge cognitive et donc de surcharge informationnelle.
Notre travail de mémoire repose sur une enquête par questionnaire conduite du mois de mai au mois d’août 2024 auprès de 171 journalistes en Suisse romande. L’échantillon se veut quasi-représentatif en termes d’âge (de 21 à 64 ans) et de genre (56,1% sont des hommes et 43,9% des femmes). Les journalistes de l’échantillon sont issus de médias écrits, audiovisuels et numériques. Certains d’entre eux occupent des postes à responsabilité. Les données récoltées sont à la fois quantitatives et qualitatives, et permettent aux journalistes interrogés de décrire leur rapport à la surcharge informationnelle. Elles ont également permis d’identifier les différents facteurs qui conduisent à la fatigue informationnelle, les symptômes associés ainsi que les stratégies adoptées afin de séparer la sphère professionnelle de la sphère privée. De plus, des analyses croisées ont été effectuées dans le but d’explorer les différences de résultats selon les genres, les âges, le type de média et la position hiérarchique.
Les premiers résultats de l’enquête révèlent que 44% des journalistes de l’échantillonnage se disent touchés par la fatigue informationnelle, contre 38% qui ne la ressentent pas. Les 18% restants indiquent une variabilité selon les circonstances. De plus, la moitié des journalistes (49,7%) ont déclaré que l’actualité avait un impact sur leur santé mentale. Bien que peu de littérature parle de la surcharge informationnelle qui pèse sur les journalistes, force est de constater que ceux-ci sont bien touchés par le phénomène.
Les femmes plus nombreuses
Des différences démographiques se ressentent parmi les résultats obtenus. En effet, les femmes (47%) sont légèrement plus nombreuses à dire qu’elles ressentent de la fatigue informationnelle que les hommes (43%). Cependant, la santé mentale de la gente féminine (65%) semble davantage touchée par l’actualité que celle de leurs confrères masculins (37%). Les symptômes incluent fatigue, anxiété, sentiment d’impuissance face à l’abondance de nouvelles négatives et, dans certains cas, épuisement émotionnel.
Les analyses révèlent que les journalistes les plus jeunes (21-31 ans) et les plus âgés (54-64 ans) semblent les plus vulnérables à la fatigue informationnelle, même si aucune tendance nette ne se dégage. En ce qui concerne le registre professionnel, la fatigue informationnelle semble particulièrement présente chez les journalistes qui travaillent dans la presse écrite. De plus, les journalistes web et les personnes qui occupent des postes à responsabilité, comme les rédacteurs en chef ou les chefs de rubrique, sont plus exposés à la surcharge informationnelle que leurs collègues avec moins de responsabilités. Ces personnes sont confrontées à un volume d’informations particulièrement élevé, ce qui leur faire ressentir davantage la surcharge informationnelle. Les journalistes travaillant dans les rubriques qui traitent les nouvelles générales, politiques ou internationales sont également sensibles à l’infobésité, en raison de la densité et de la gravité des sujets traités.
La majorité des journalistes de l’échantillon déclarent mettre en place des stratégies afin de limiter leur exposition constante à l’information et de maintenir une frontière entre leur vie privée et professionnelle. Beaucoup d’entre eux disent désactiver les notifications lorsqu’ils ne travaillent pas, éteindre leur téléphone portable ou en posséder un second pour dissocier distinctement les deux sphères de leur vie. Malgré l’existence de nombreuses stratégies, 21% de l’échantillon déclarent ne pas se déconnecter complètement lorsqu’ils ne sont pas au travail. D’une part à cause de la difficulté de tracer une frontière nette entre vie professionnelle et personnelle et, d’autre part, en raison du sentiment d’obligation de rester connecté pour être au courant de tout ce qu’il se passe afin d’être performant au travail.
Les résultats de cette étude illustrent une tension entre la nécessité de suivre l’actualité en continu, perçue comme essentielle au métier, et ses effets délétères sur la santé mentale des journalistes. La profession, souvent considérée comme une vocation, favorise une implication intense qui peut conduire à des formes de surinvestissement. Le contexte numérique, par ailleurs, exacerbe la difficulté à se déconnecter de l’actualité.
Un défi majeur
Même si la thématique est très peu commentée et rarement étudiée dans la littérature scientifique, ainsi que peu discutée au sein même des rédactions, la fatigue informationnelle constitue un défi majeur pour les journalistes. Bien que certaines tendances se dégagent quant à sa portée sur les journalistes en fonction du genre, de l’âge, du canal de diffusion et du poste occupé, tous les journalistes peuvent se retrouver confrontés à la surcharge cognitive. Celle-ci dépend principalement de facteurs individuels. Tout le monde n’est pas atteint de la même manière et au même moment (Sauvajol-Rialland, 2014).
Les résultats de cette étude suggèrent un besoin urgent de développer des stratégies organisationnelles et personnelles pour protéger le bien-être des journalistes, notamment en favorisant des pratiques de déconnexion et de gestion des priorités. Ces efforts sont essentiels pour préserver la qualité de l’information tout en protégeant la santé mentale des journalistes.
Bibliographie
Bouron, S., Devillard, V., Leteinturier, C., & Le Saulnier, G. (2017). L’insertion et les parcours professionnels des diplômés de formations en journalisme. [Rapport de recherche, Université Panthéon-Assas, Paris II]
Devillard, V., & Saulnier, G. L. (2020). Sortir du journalisme. Les diplômés en journalisme entre emplois instables et carrières déviantes. Recherches en Communication, 43, 79-104.
Eppler, M. J., & Mengis, J. (2004). The Concept of Information Overload: A Review of Literature from Organization Science, Accounting, Marketing, MIS, and Related Disciplines (2004). The Information Society: An International Journal, 20(5).
Sauvajol-Rialland, C. (2014). Infobésité, gros risques et vrais remèdes. L’Expansion Management Review, 152, 110-118. https://doi.org/10.3917/emr.152.0110
Cet article est publié sous licence Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Il peut être republié à condition que l’emplacement original (fr.ejo.ch) et les auteurs soient clairement mentionnés, mais le contenu ne peut pas être modifié.
Cet article est tiré du mémoire de fin de Master de Mathilde Schott, ancienne étudiante à l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel.
Tags: news fatigue, santé mentale, surcharge informationnelle


















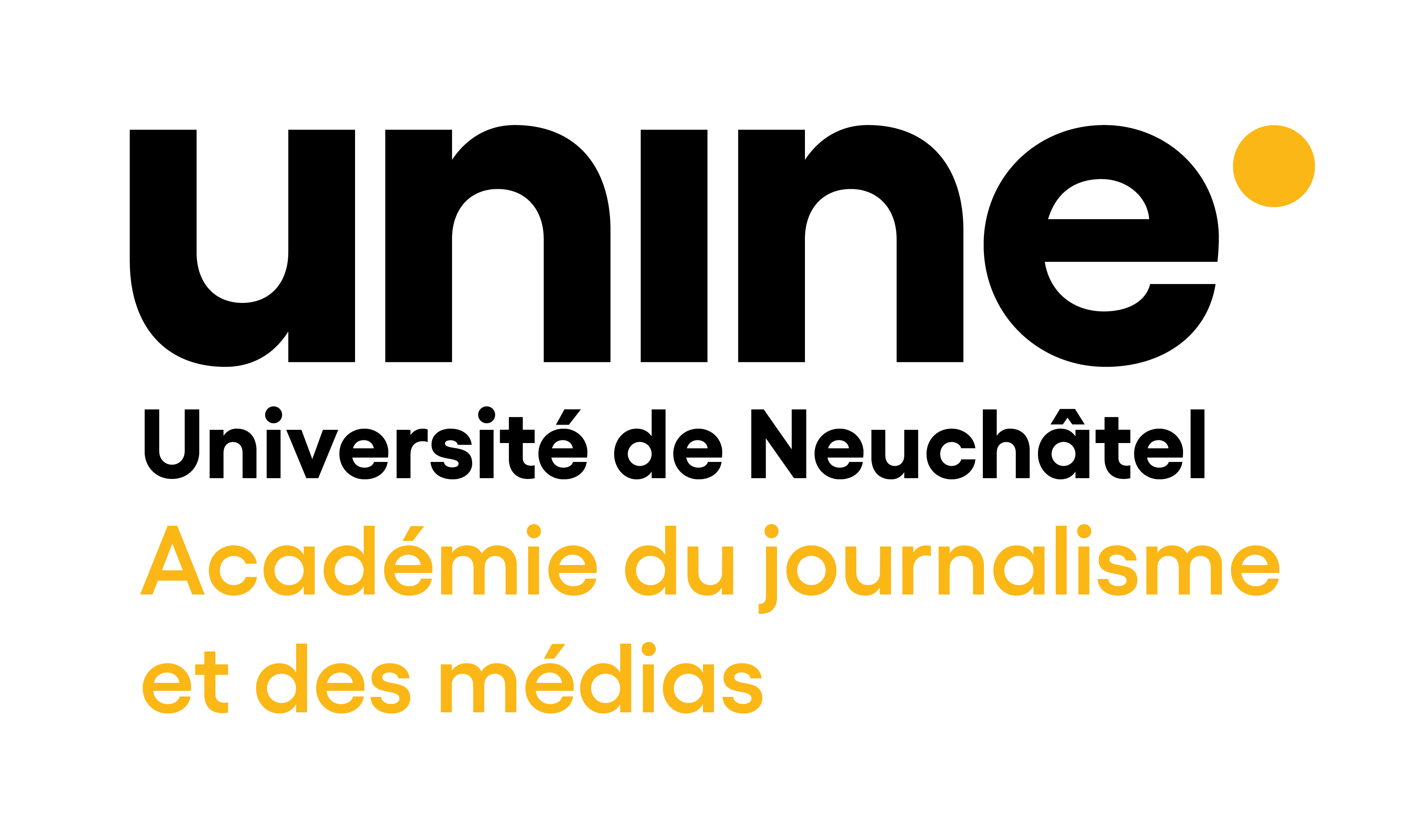

[…] Text wurde zuerst auf der französischen EJO-Seite […]